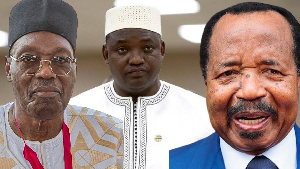Patrice Nganang et Achille Mbembe ont tenu les internautes en haleine ces derniers temps. Le premier condamne le second d’avoir délibérément omis d’évaluer sa demande de promotion.
Il a profité de l’occasion pour clouer au pilori tous les compatriotes qui mettent les bâtons dans les roues à ceux qui sont plus jeunes qu’eux. En vérité, cet homme qui joue la victime n’est pas différent de ceux qu’il fustige. C’est ce que je vais démontrer dans les lignes qui suivent.
Nganang est mon aîné de 3 ans. J’avais fait sa connaissance en 1996. C’était en Allemagne. Cette année-là, le DAAD (office allemand d’échanges universitaires) m’avait octroyé une bourse d’études pour que je puisse préparer mon mémoire de maîtrise à l’Université Johann Wolfgang Goethe de Francfort-sur-le-Main.
Au fait, je n’étais pas le seul boursier de ma promotion. Joachim Oelsner, le lecteur du DAAD, m’avait envoyé à Francfort avec Félix Tagne Djom qui est Bamiléké comme moi. À l’aéroport de Yaoundé, nous prîmes le même vol que les Bétis Hyacinthe Ondoa et Marie Onana Biloa, mais nous nous séparâmes d’eux à Bruxelles ; leur destination était Berlin.
Le jour de notre arrivée à Francfort, Barbara Könneker, la codirectrice de notre mémoire, nous demanda si nous connaissions Alain Patrice Nganang. Nous donnâmes une réponse négative à sa question. Alors, elle nous informa qu’il s’agissait d’un germaniste camerounais qui préparait une thèse à l’université de la ville.
Le jour suivant, elle nous le présenta et le chargea de nous conduire à la caisse d’assurance-maladie où nous devions nous affilier, et à la banque où notre première mensualité était déjà disponible. Il le fit. De plus, il nous montra le centre-ville et nous invita chez lui à Offenbach, une ville limitrophe de Francfort.
Il vivait en concubinage avec la Germano-zimbabwéenne Nyasha Bakare. Cette métisse faisait des études de médecine. De temps à autre, Nganang et moi parlions notre langue maternelle, le medúmbà.
La pension qui fut accordée à Tagne et moi avait une durée de 6 mois. Soit dit en passant, Nganang était aussi boursier du DAAD. Bientôt, ce compatriote commença à recourir à l’intrigue pour nous induire en erreur. Il déployait toutes les ressources de son talent pour nous convaincre qu’il était hasardeux d’aspirer aux études doctorales après l’obtention de la maîtrise. Pourtant, c’est ce qu’il avait fait.
Il nous servait de modèle, nous voulions marcher sur ses traces. C’était clair que nous disposions du potentiel intellectuel nécessaire pour réaliser nos rêves.
Comme il savait que l’École Normale Supérieure de Yaoundé nous avait accordé une mise en disponibilité et que nous avions de ce fait la possibilité d’y poursuivre la formation, il ressassait que nous avions intérêt à ne nourrir d’autre ambition que celle de devenir professeurs de lycée. Finalement, il réussit à fléchir la volonté de Tagne.
Jusqu’aujourd’hui, ce dernier pâtit de ce sale coup. J’essayai en vain de l’amener à mettre des garde-fous. Il semblait être hypnotisé par une force surnaturelle.
La veille de son retour au pays natal, Nganang vint à notre résidence universitaire, flanqué d’une poignée des membres de l’association des étudiants camerounais de Francfort dont Tagne fut le secrétaire. J’habitais au quatorzième étage de l’immeuble 40, Ginnheimer Landstraße.
Quand je revins de la bibliothèque ce soir-là, je trouvai donc Nganang, ses acolytes et Tagne dans la cuisine. Ce dernier vivait depuis quelque temps chez moi, car il n’avait pas sollicité le prolongement de son bail avant la fin de la bourse.
Il me montra un magnétoscope flambant neuf et d’autres objets que le groupe de visiteurs lui avait offerts en guise d’adieu. En outre, il lui avait promis de le faire revenir en Allemagne pour que qu’il en exprime le souhait. Vers vingt-deux heures, tous les visiteurs s’en allèrent, sauf Nganang. Il passa la nuit chez moi pour s’assurer que sa victime voyagera effectivement. Et ce n’est pas tout ! Dès l’aube, il l’accompagna à l’aéroport.
Après avoir pris les dispositions nécessaires, je voyageai au Cameroun quelques mois plus tard, soutins mon mémoire au département d’études germaniques de l’Université de Yaoundé I et repartis en Allemagne pour faire des études doctorales.
Mon mémoire portait sur la problématique de la liberté et de l’individualité dans deux pièces de Goethe. À propos de Goethe, Nganang me disait souvent qu’il avait « tué » beaucoup de ses contemporains parce qu’il produisait beaucoup.
Pour nous « tuer » à son tour, l’écrivain camerounais n’hésitait pas à nous lire tout haut le manuscrit de son roman « La promesse des fleurs. » Nous, c’est-à-dire les autres germanistes africains en séjour ou de passage à Francfort. Il profitait de ces occasions pour nous parler de son recueil de poèmes « Elobi. »
Pourtant, un jour, alors qu’il contemplait mes étagères, il sursauta soudainement et poussa un cri de surprise.
– Qu’est-ce qu’il y a ? lui demandai-je.
Il prit le mémoire susmentionné, le feuilleta et dit avec amertume : – C’est donc possible de publier un mémoire ? Si j’avais su ! J’aurais dû publier le mien à l’époque. Hélas, il est trop tard !
Je n’ai plus souvenance du plat que je lui avais servi ce jour-là, mais ce qui me frappa fut le fait que cette découverte lui coupât l’appétit.
Nganang est un esprit retors, un mauvais génie. Un jour, je fis la connaissance d’une Suisse allemande du nom de Marie-Hélène Gutberlet. Elle faisait des études théâtrales, cinématographiques et de filmologie à l’Université de Francfort. Nous étions au deuxième cycle. Nous tombâmes amoureux l’un de l’autre.
Elle était d’une beauté envoûtante et maniait aussi la langue de Molière. Elle aimait l’Afrique noire où elle avait d’ailleurs passé une partie de son enfance. Elle me donna rendez-vous à un café-restaurant. J’étais tellement heureux que je me rendis à Offenbach pour parler de cette conquête à mon aîné Nganang, d’autant plus qu’il me faisait souvent des observations sur le fait que je n’eusse pas de petite amie. Quand je descendis du train à la gare centrale d’Offenbach, je me mis à courir. J’étais ivre de joie.
En trois minutes, j’atteignis le domicile de Nganang. Après que je lui avais annoncé la nouvelle, il m’amena à un étang qui se trouvait de l’autre côté de la rue. On s’assit un banc public. Quelques canards nageaient, des oiseaux gazouillaient dans les arbres. Nganang me dit :
– Hilaire, c’est bien que tu sois venu me parler de la fille que tu as tombée. Le ciel soit loué ! En effet, je connais Marie-Hélène. Elle mène une vie de débauche. Elle sort avec plusieurs Noirs de Francfort et ses environs. Bref, c’est une roulure, une traînée. Tu devrais l’éviter dans ton intérêt.
Tout de même, j’allai au rendez-vous galant. Gutberlet vint en vélo. On ne voyait pas le temps passer. La nuit tomba pendant que nous étions dans le café-restaurant. Nous décidâmes d’aller danser ! Aussitôt dit, aussitôt fait. La boîte de nuit qu’elle choisit était à un jet de pierre.
Comme la majorité des clients étaient des Noirs américains, je me demandais si Nganang n’avait pas dit la vérité. Vers quatre heures du matin, ma dulcinée et moi quittâmes la discothèque. Nous allâmes chez elle à pied. Ce n’était pas loin. Mais à sa plus grande déception, je refusai de franchir le seuil de la porte d’entrée de l’immeuble où elle logeait.
Elle se jeta à mes pieds, me supplia de ne pas briser son cœur, etc. Me voyant m’éloigner, elle s’étendit sur le pavé. Elle s’arrachait les cheveux. Je l’entendis sangloter. J’avais le cœur gros, je voulais me retourner et accéder à son désir, mais une autre chose qui me troublait, c’était la zone où elle résidait. C’était justement au quartier chaud de la ville ! J’avais vingt-quatre ans.
Un an plus tard, quand je me rendis compte de la supercherie de Nganang, je tentai de renouer avec Gutberlet. Je lui expédiai une lettre dans laquelle j’alléguai que je l’avais laissée en plan parce que j’étais puceau… Elle trouva par conjecture que c’était un faux motif. Dans sa lettre de réponse, elle m’informa qu’elle était déjà prise et daigna me donner le conseil suivant : « Sache que les femmes sont aussi des être humains. »
Entre-temps, elle préparait une thèse sur le cinéma africain. Quatre ans plus tard, je la revis. On se croisa dans l’immeuble abritant son département et le mien. On échangea quelques paroles. Je lui demandai maladroitement si le bébé qu’elle portait était le sien. Il n’était pas métis. Elle remarqua sarcastiquement que j’aurais été le père de ses enfants si je n’avais pas été sans cœur. Aujourd’hui, elle vit avec sa famille à Francfort où elle travaille.
Nganang de son côté vit avec la sienne aux à New York où il travaille. Après avoir été recruté comme assistant à l’Université de Shippensburg en l’an 2000, il me confia qu’on m’aurait sûrement préféré à lui si j’avais postulé au même poste. Il m’enviait donc de préparer une thèse sur Heinrich Mann et André Gide !
Vu qu’il enseignait l’allemand et le français, il aurait aimé comparer les écrits de Bertolt Brecht avec ceux d’un écrivain de langue française et non avec ceux de Wole Soyinka. De ses aînés, Ambroise Kom est le seul dont il parle en termes élogieux. Kom l’a aidé à se mettre en selle, notamment en appuyant ses candidatures.
Kom, qui est spécialiste de littérature, a certainement déjà pris sa retraite, puisqu’il avait environ 10 ans en 1959. Si ce n’était pas le cas, Nganang aurait proposé à son université de lui soumettre sa demande de promotion, d’autant plus que ce dernier était professeur titulaire à un institut universitaire aux États-Unis.
S’il a proposé l’historien Mbembe qui enseigne Afrique du Sud, c’est parce qu’il n’a pas eu d’autre choix. Nganang crie sur tous les toits qu’il est une lumière alors qu’il détient un poste permanent à l’Université d’État de New York qui ne fait pas partie des universités prestigieuses des États-Unis. S’il était un géant comme il le prétend, lesdites universités se l’arracheraient.
Il use de stratagèmes pour empêcher les gens qui ont des aspirations élevées de faire des progrès. Il aime faire la concurrence déloyale. Il perd le sommeil à l’idée qu’une personne plus jeune que lui pourrait l’égaler ou le surpasser. Mais il ne se contente pas de couper les ponts derrière soi, non, il utilise la combine pour fourvoyer ceux qu’ont croit capable de transformer l’eau et la boue en or.
Quand mon premier roman sortit en 2007, Nganang m’appela pour m’enjoindre de ne pas écrire d’autres livres. Pourtant, à l’époque où nous séjournions en Allemagne, il m’avait conseillé de prendre la plume pour fustiger les maux qui minent la société camerounaise. En me donnant ce conseil, il était convaincu que je n’étais pas pourvu d’un tel talent.
Pour modifier la citation du peintre italien Le Corrège, je m’écrie : « Et moi aussi je porte en moi tout un monde, et moi aussi je suis écrivain ! » Non seulement je suis un auteur bilingue, je suis de surcroît prolifique. Tout cela aigrit mon collègue Nganang, oui, ça exacerbe sa jalousie.
Lorsqu’un journaliste allemand lui demanda pourquoi il n’écrit ses ouvrages littéraires qu’en français, il s’avoua incapable de le faire dans la langue de Goethe. Il sait que je suis de loin plus intelligent que lui et que j’ai un C.V. plus riche que le sien. Je suis le seul contemporain capital qu’il n’a pas pu « tuer. » Mais il continue à recourir aux moyens habiles et détournés dans le but d’éteindre mon étoile.
Il y a quelques mois, je lui ai demandé s’il pouvait me recommander pour un poste qui était à pourvoir à la prestigieuse Université Harvard. L’intrigant a laissé mon message sans réponse. En 2008, ce roublard m’avait envoyé quelques dollars pour me permettre de monter un projet de recherche postdoctorale.
Il se déclara prêt à appuyer ma demande de bourse et même me suggéra de solliciter la seconde lettre de recommandation auprès de Barbara Könneker. Lorsque je déposai ma demande en janvier 2010, cette Allemande me recommanda.
Par contre, Nganang manqua à sa promesse sous prétexte que je n’avais pas voulu le rencontrer pour parler de mon projet ! Est-ce que j’avais rencontré Könneker ? En effet, Nganang avait séjourné au Cameroun en décembre de l’année précédente. Il avait perdu sa mère.
Étant donné que c’est un individu qui a plus d’un tour dans son sac, j’avais effectivement évité de le rencontrer. Une telle rencontre n’était pas du tout nécessaire, puisqu’il avait en sa possession les documents nécessaires pour rédiger sa lettre de recommandation.
Il n’avait pas besoin de l’envoyer par poste, car la fondation, qui est basée en France, accorde la préférence au transfert des fichiers sur Internet. Nganang laissa passer la date limite d’envoi. Néanmoins, la fondation nous alerta deux jours plus tard et lui accorda un délai à titre exceptionnel, à savoir 24 heures supplémentaires. Nganang laissa aussi ce délai expirer ! De ce fait, mon dossier resta incomplet.
En vérité, mon aîné Nganang a cherché à plusieurs reprises à m’enterrer. Déjà en 2009, il m’avait trahi dans le conflit qui m’opposa au bandit de grand chemin Gervais Mendo Ze et à ses complices de l’Université de Yaoundé I. J’étais donc aux prises avec les forces des ténèbres. J’avais mis Nganang au courant de cette lutte opiniâtre.
Mais au lieu de condamner ces ennemis de la transparence managériale, il prit parti contre moi, me reprochant d’être imprudent et de vouloir qu’il perde inutilement le peu d’amis qu’il a au Cameroun. Il tenta même de me repousser dans les flammes desquelles j’avais réchappé. L’an dernier, Mendo Ze alla en prison. J’ai donc raison.
Si j’avais les moyens, je le traînerais avec l’Université de Yaoundé I devant les tribunaux. J’ai subi un énorme préjudice, car au moment où les amis de Nganang m’éjectaient de ladite université, le professeur Norbert Bachleitner de l’Université de Vienne se préparait à m’accueillir dans le cadre d’un projet de recherche pour lequel lui et moi sollicitions un financement s’élevant à plusieurs dizaines de millions de francs.
Nganang est un ingrat. Je l’avais beaucoup aidé en Allemagne. Chaque fois qu’il devait s’envoler pour le Cameroun, il me priait de l’accompagner à l’aéroport, car il croyait que l’avion était comparable à ces vieux cars qui font la navette entre Yaoundé et Bertoua. Comme il ne prévoyait jamais l’argent pour l’excédent des bagages, il me le confiait et passait le chercher à son retour.
Après qu’il fut reçu docteur, son frère Hervé Yonkeu, sa concubine Nyasha et lui durent changer de domicile. De tous leurs amis, je fus le seul à accepter de leur prêter main-forte pour le déménagement. À propos, Yonkeu est aussi ingrat que son grand frère. En 1997, lorsque je venais au Cameroun pour soutenir mon mémoire, Nganang m’avait confié une lettre contenant des documents dont Yonkeu avait besoin pour compléter sa demande de visa.
Je me rendis au quartier Madagascar, Yaoundé, pour remettre ladite lettre à leur mère. Elle nous exhorta à être toujours solidaires, message que je transmis à Nganang. Ce dernier hébergea son petit frère jusqu’au moment où il eut l’occasion d’aller faire la recherche postdoctorale à Berlin.
En ce temps-là, je vivais à Friedberg. Je permis à Yonkeu d’obtenir une chambre dans ma résidence universitaire du 4, Steinkaute. Elle était gérée par l’Université de Gießen. Friedberg est un bourg à mi-chemin entre Francfort-sur-le-Main et Gießen.
Le jour où Nganang et Nyasha convolèrent en justes noces, ma chaîne haute-fidélité distilla la musique durant la réception à Offenbach. Il avait porté son choix sur mon appareil. Célestin Tagou, actuellement doyen de la faculté des sciences sociales et relations internationales de l’Université Protestante d’Afrique Centrale, eut la gentillesse d’amener l’appareil à Offenbach. Je l’installai moi-même. Sauf erreur de ma part, la bâtisse où la réception eut lieu se trouvait à côté d’un pont ferroviaire.
Si j’ai gardé le silence sur les défauts et péchés de Nganang jusqu’ici, c’est parce que je ne voulais pas tourner en dérision quelqu’un qui est, tout comme moi, un pourfendeur du dictateur Biya. J’ai eu à attirer son attention sur les faits que je lui reproche dans le présent libelle, mais il n’a jamais cherché à exorciser la gangrène de l’individualisme qui l’habite.
Ce sont les invectives qu’il a lancées contre Mbembe qui m’ont poussé à briser le silence.
Opinions of Wednesday, 3 June 2015
Auteur: Hilaire Mbakop